révolutions intérieures et au travail plutonique, qui
modifiaient subitement les linéaments encore incertains de la surface
terrestre. Ici, des intumescences qui devenaient montagnes; là, des
gouffres que devaient emplir des océans ou des mers. Et alors, des
forêts entières s'enfonçaient dans la croûte terrestre, à travers les
couches mouvantes, jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé un point d'appui,
tel que le sol primitif des roches granitoïdes, ou que, par le tassement,
elles formassent un tout résistant.
En effet, l'édifice géologique se présente suivant cet ordre dans les
entrailles du globe : le sol primitif, que surmonte le sol de remblai,
composé des terrains primaires, puis les terrains secondaires dont les
gisements houillers occupent l'étage inférieur, puis les terrains tertiaires,
et au-dessus, le terrain des alluvions anciennes et modernes.
A cette époque, les eaux, qu'aucun lit ne retenait encore et que la
condensation engendrait sur tous les points du globe, se précipitaient en
arrachant aux roches, à peine formées, de quoi composer les schistes,
les grès, les calcaires. Elles arrivaient au dessus des forêts tourbeuses et
déposaient les éléments de ces terrains qui allaient se superposer au
terrain houiller. Avec le temps -- des périodes qui se chiffrent par
millions d'années --, ces terrains se durcirent, s'étagèrent et enfermèrent
sous une épaisse carapace de poudingues, de schistes, de grès compacts
ou friables, de gravier, de cailloux, toute la masse des forêts enlisées.
Que se passa-t-il dans ce creuset gigantesque, où s'accumulait la
matière végétale, enfoncée à des profondeurs variables ? Une véritable
opération chimique, une sorte de distillation. Tout le carbone que
contenaient ces végétaux s'agglomérait, et peu à peu la houille se
formait sous la double influence d'une pression énorme et de la haute
température que lui fournissaient les feux internes, si voisins d'elle à
cette époque.
Ainsi donc un règne se substituait à l'autre dans cette lente, mais
irrésistible réaction. Le végétal se transformait en minéral. Toutes ces
plantes, qui avaient vécu de la vie végétative sous l'active sève des
premiers jours, se pétrifiaient. Quelques-unes des substances enfermées
dans ce vaste herbier, incomplètement déformées, laissaient leur
empreinte aux autres produits plus rapidement minéralisés, qui les
pressaient comme eût fait une presse hydraulique d'une puissance
incalculable. En même temps, des coquilles, des zoophytes tels
qu'étoiles de mer, polypiers, spirifères, jusqu'à des poissons, jusqu'à des
lézards, entraînés par les eaux, laissaient sur la houille, tendre encore,
leur impression nette et comme « admirablement tirée [1*] ».
La pression semble avoir joué un rôle considérable dans la formation
des gisements carbonifères. En effet, c'est à son degré de puissance que
sont dues les diverses sortes de houilles dont l'industrie fait usage.
Ainsi, aux plus basses couches du terrain houiller apparaît l'anthracite,
qui, presque entièrement dépourvue de matière volatile, contient la plus
grande quantité de carbone. Aux plus hautes couches se montrent, au
contraire, le lignite et le bois fossile, substances dans lesquelles la
quantité de carbone est infiniment moindre. Entre ces deux couches,
suivant le degré de pression qu'elles ont subie, se rencontrent les filons
de graphites, les houilles grasses ou maigres. On peut même affirmer
que c'est faute d'une pression suffisante que la couche des marais
tourbeux n'a pas été complètement modifiée.
Ainsi donc, l'origine des houillères, en quelque point du globe qu'on les
ait découvertes, est celle-ci : engloutissement dans la croûte terrestre
des grandes forêts de l'époque géologique, puis, minéralisation des
végétaux obtenue avec le temps, sous l'influence de la pression et de la
chaleur, et sous l'action de l'acide carbonique.
Cependant, la nature, si prodigue d'ordinaire, n'a pas enfoui assez de
forêts pour une consommation qui comprendrait quelques milliers
d'années. La houille manquera un jour, -- cela est certain. Un chômage
forcé s'imposera donc aux machines du monde entier, si quelque
nouveau combustible ne remplace pas le charbon. A une époque plus
ou moins reculée, il n'y aura plus de gisements carbonifères, si ce n'est
ceux qu'une éternelle couche de glace recouvre au Groenland, aux
environs de la mer de Baffin, et dont l'exploitation est à peu près
impossible. C'est le sort inévitable. Les bassins houillers de l'Amérique,
prodigieusement riches encore, ceux du lac Salé, de l'orégon, de la
Californie, n'auront plus, un jour, qu'un rendement insuffisant. Il en
sera ainsi des houillères du cap Breton et du Saint-Laurent, des
gisements des Alleghanis, de la Pennsylvanie, de la Virginie, de
l'Illinois, de l'Indiana, du Missouri. Bien que les gîtes carbonifères du
Nord-Amérique soient dix fois plus considérables que tous les
gisements du monde entier, cent siècles ne s'écouleront pas sans que le
monstre à millions de gueules de l'industrie n'ait dévoré le dernier
morceau de houille du globe.
La disette, on le comprend, se fera plus promptement sentir dans
l'ancien monde. Il existe bien des couches de combustible minéral en
Abyssinie, à Natal, au Zambèze, à Mozambique, à Madagascar, mais
leur
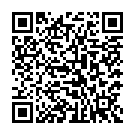
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



