mieux traiter la question sous une
forme expérimentale.
Sur ce dernier point, je crois intéressant de remarquer que Bérillon se contente d'affirmer
sans rien prouver. On aurait été curieux d'avoir sous les yeux une statistique de bons
élèves et de mauvais élèves, et d'étudier le pourcentage des hypnotisables dans ces deux
catégories. C'est ainsi que nous procédons en psychologie expérimentale, nous donnons
nos chiffres, et nous les laissons parler. L'habitude maintenant est si bien prise que
lorsque nous rencontrons une affirmation sans preuves, nous la considérons comme une
impression subjective, sujette à des erreurs de toutes sortes. Voilà ce qu'aurait dû se
rappeler un auteur américain, M. Luckens[15], qui dit avoir été très frappé, dans une
visite faite à Bérillon, de cette assimilation de la suggestibilité à l'éducabilité; il aurait dû
demander des preuves, et jusqu'à ce qu'elles lui eussent été fournies, suspendre son
jugement[16].
[Note 15: Luckens. Notes abroad, Pedagogical Seminary, 10, 1898.]
[Note 16: Je crois devoir ajouter quelques remarques sur les rapports pouvant exister
entre la suggestibilité d'une personne et son intelligence. Il me paraît incontestable qu'un
certain degré d'intelligence est nécessaire pour comprendre la suggestion donnée, et une
personne qui ne comprendra pas une suggestion trop complexe pour son intelligence se
trouvera, par ce fait même, incapable de l'exécuter; l'échec ne viendra pas de son défaut
de suggestibilité, mais de son défaut d'intelligence. Je prends tout de suite un exemple: un
enfant d'école primaire ne pourra pas, par suggestion, résoudre une équation à deux
inconnues, ou faire un problème de calcul intégral. Dans ce sens, on peut dire que
l'intelligence du sujet n'est pas sans relation avec sa suggestibilité. Nous rencontrons du
reste cette relation lorsque nous nous adressons pour nos recherches aux enfants très
jeunes; à cinq ans, et à six ans, un enfant me paraît être en général beaucoup plus
suggestible qu'à neuf ans; mais son extrême suggestibilité se trouve neutralisée dans bien
des cas par son incapacité à comprendre la suggestion.]
J'ai fait il y a cinq ans environ, en collaboration avec V. Henri, des expériences de
suggestion qui rentrent dans cette catégorie, c'est-à-dire qui sont la mise en oeuvre de
l'autorité morale; ce n'étaient point des suggestions d'actes ou de sensations; la suggestion
était dirigée de manière à troubler seulement un acte de mémoire. Une ligne modèle de 40
millimètres de longueur étant présentée à l'enfant, il devait la retrouver, par mémoire ou
par comparaison directe, dans un tableau composé de plusieurs lignes, parmi lesquelles se
trouvait réellement la ligne modèle. Au moment où il venait de faire sa désignation, on
lui adressait régulièrement, et toujours sur le même ton, la phrase suivante: «En êtes-vous
bien sûr? N'est-ce pas la ligne d'à côté?» Il est à noter que sous l'influence de cette
suggestion discrète, faite d'un ton très doux, véritable suggestion scolaire, la majorité des
enfants abandonne la ligne d'abord désignée et en choisit une autre. La répartition des
résultats montre que les enfants les plus jeunes sont plus sensibles à la suggestion que
leurs aînés: en outre, la suggestion est plus efficace quand l'opération qu'on cherche à
modifier est faite de mémoire que quand elle est faite par comparaison directe
(c'est-à-dire le modèle et le tableau de lignes se trouvant simultanément sous les yeux de
l'enfant); voici quelques chiffres:
NOMBRE DES CAS OÙ LES ENFANTS ONT CHANGÉ LEUR RÉPONSE
Dans la Dans la comparaison Moyenne. mémoire. directe.
Cours élémentaire. 89% 74% 81,5%
-- moyen. 80% 73% 76,5%
-- supérieur. 54% 48% 51%
Dans ces chiffres sont confondus les enfants qui, avant la suggestion, ont fait une
désignation exacte de la ligne égale au modèle, et les enfants qui ont fait une désignation
fausse. Il faut maintenant distinguer ces deux groupes d'enfants, dont chacun présente un
intérêt particulier. Les enfants qui se sont trompés une première fois font en général une
désignation plus exacte, grâce à la suggestion; ainsi, si l'on compte ceux dont la seconde
désignation se rapproche plus du modèle que la première, on en trouve 81 p. 100, tandis
que ceux qui s'en éloignent davantage forment une petite minorité de 19 p. 100. Quant
aux enfants qui ont vu juste la première fois, ils sont remarquables par la fermeté avec
laquelle ils résistent à la suggestion, qui, dans leur cas, est perturbatrice; 56 p. 100
seulement abandonnent leur première opinion, tandis que dans le cas d'une réponse
inexacte, il y en a 72 p. 100 qui changent de désignation.
Je ferai remarquer que cette étude de V. Henri et de moi a été conçue dans un esprit un
peu différent de celui qu'on trouve dans d'autres travaux du même genre. Nous ne nous
sommes pas simplement proposés de montrer que les enfants, ou que tels et tels enfants
sont suggestibles, mais nous avons cherché à préciser le mécanisme de cette
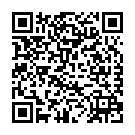
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



