représentation suffisamment objective du monde matériel et, tout au moins, le sentiment net d'une certaine régularité dans les choses. Avant d'être con?ue, la loi de causalité a été de mieux en mieux sentie par le déploiement de l'activité humaine dans un monde régi par cette loi et dont l'homme est partie intégrante.
La technique a précédé la technologie et, à plus forte raison, la science; mais elle a préparé l'une et l'autre, ?La technique est mère de la logique rationnelle[26].?
[Note 26: RIBOT, Logique des sentiments, p. 27. Cf. ESPINAS, Les origines de la technologie.]
* * *
Bien plut?t que Homo Sapiens, l'homme aux origines, est Homo Faber. Et il demeure Homo Faber. Nous aurons à montrer plus tard que, décisif au début, le r?le de la technique est immense tout le long de l'évolution humaine[27]: l'homme est ?ouvrier et ingénieur?, ?fabricant infatigable d'outils, d'instruments, de machines?[28].
[Note 27: C'est la part de vérité qu'enferme le matérialisme historique ou économique.]
[Note 28: P. LACOMBE. Rev. de Synth. hist., t. XXIV, p. 369. Pour P. Lacombe, comme pour Weber, par opposition à Auguste Comte, la première phase de l'humanité est technique, et non théologique.]
Paul Lacombe, ce vigoureux et original théoricien de l'histoire, qui faisait une place prépondérante à l'économique[29], devait donner à notre tome XX une préface où il aurait relié la technique de la préhistoire à l'économie des Grecs et des Romains. Ce qu'il a écrit sur ces matières,--par exemple dans son Histoire considérée comme science,--certaines notes de son Journal, qui répondent à cette préoccupation, nous font vivement regretter un collaborateur si bien préparé. Non seulement il analysait avec une pénétrante ingéniosité cette évolution qui va des propriétés superficielles aux propriétés profondes des choses, et où peu à peu l'art et la science se dégagent de la technique; mais il mettait en lumière ce fait que dans l'histoire de la technique--chaine continue de l'histoire générale--la masse, la plèbe, joue sa partie, une partie capitale: ?L'histoire de la technique ne serait pas l'histoire universelle, mais à coup s?r la plus universelle des histoires, puisque l'homme de tous les temps a été en grande masse un ouvrier [30].?
[Note 29: Sur Lacombe, voir H. BERR, L'Histoire traditionnelle et la Synthèse historique pp. 57-144.]
[Note 30: Journal, 22 oc. 1814.]
C'est en nous inspirant de lui que nous reviendrons, plus tard, sur le déroulement des inventions; que nous distinguerons celles qui augmentent le pouvoir de nos mains, qui les suppléent, qui nous permettent non seulement d'utiliser les objets, mais de capter et tourner à notre profit des énergies de toutes sortes, celles qui accroissent la portée de nos sens et nous donnent, pour ainsi dire, des ?sens artificiels?, celles qui accroissent nos facilités de déplacement dans l'espace, de communication avec nos semblables; que nous insisterons sur ce développement infini de l'outillage, né de la main, dont les répercussions sont infinies elles-mêmes, absolument imprévisibles bien souvent,--et qui de l'homme a fait comme un dieu. On a observé que les machines sont des organes extérieurs qui rendent inutiles nos muscles de chair et que, par elles, nous tendons vers l'étal de ?purs esprits?.
* * *
Ce qu'on trouvera dans le présent volume, c'est l'humanité préhistorique, non pas l'homme: je veux dire qu'il ne sera pas question ici d'anthropologie préhistorique. Ce qui concerne les caractères physiques de nos lointains ancêtres--le complément des brèves indications données par M. Edmond Perrier à la fin de la Terre avant l'Histoire--sera réuni, dans le tome V de l'évolution de l'Humanité, à l'étude des races protohistoriques et de l'élément race en général. Pour une juste distribution des matières et une pleine utilisation des compétences, il a semblé bon de pratiquer cette disjonction.
M. Cartailhac, à l'origine, nous avait fait l'honneur d'apporter à notre oeuvre la grande autorité que lui a acquise une longue et probe carrière scientifique. Plus tard, il s'est méfié de ses forces,--certainement à tort; il a craint de nous retarder; et M. de Morgan, sur son désir, a bien voulu le remplacer. Comme devait le faire M. Cartailhac, l'ancien directeur des antiquités de l'égypte et délégué général en Perse a traité le sujet de l'activité humaine considérée dans les premières traces qui en subsistent et marqué les grandes étapes primitives du progrès humain.
De cette science, très fran?aise, du préhistorique, M. de Morgan est un des représentants les plus éminents. Personne ne l'embrasse avec une curiosité plus large et un savoir plus étendu. Les ouvrages relatifs à la préhistoire prennent tous pour base nos régions et négligent l'Orient. Il n'y a pas là seulement une insuffisance de documentation mais, peut-être, une erreur de point de vue. C'est l'Orient, semble-t-il, qui a joué, aux origines, le r?le prépondérant. La vérité consiste, dans tous les cas, à mettre en parallèle l'évolution de ces contrées et celles de l'Occident européen, à fondre les notions qu'on possède sur l'une et sur l'autre. M.
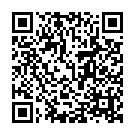
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



